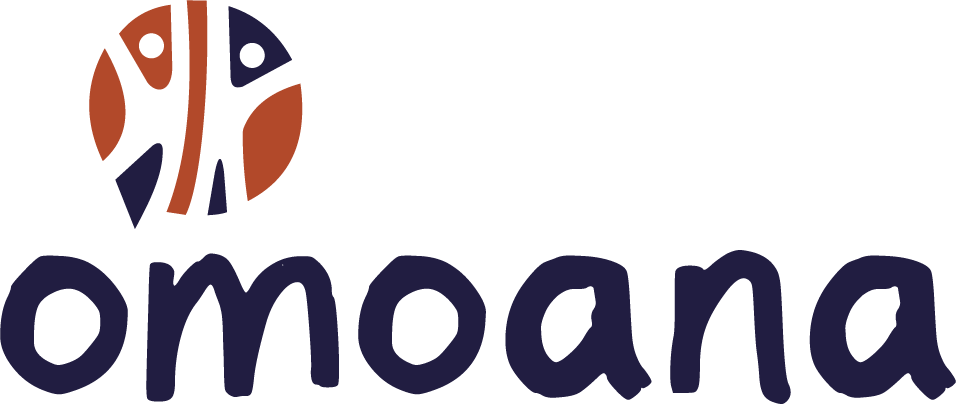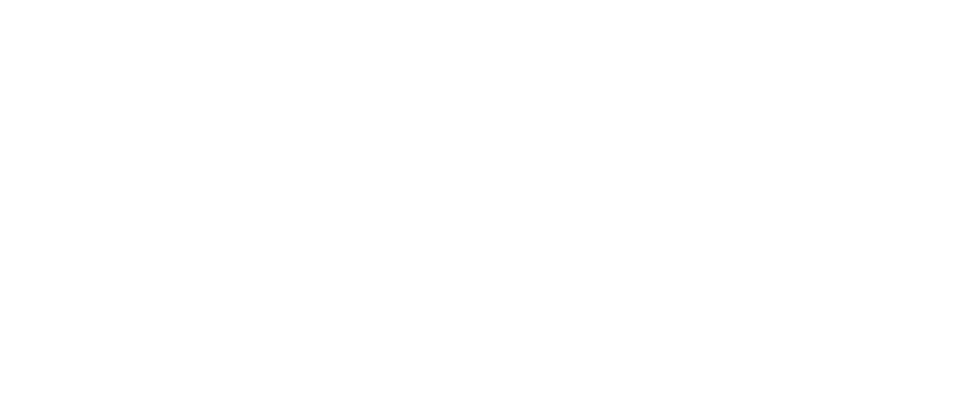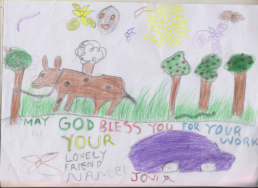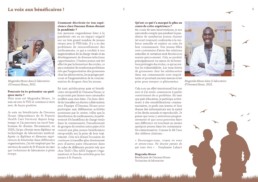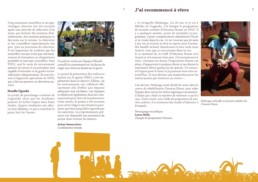Développer les compétences sociales et prévenir la violence
Depuis septembre 2022, Omoana a mis en œuvre un processus participatif avec ces partenaires dans le but d’améliorer leur pratique dans le soutien psychosocial et la prévention de la violence auprès des jeunes. Celui-ci vise à se pencher sur les leçons apprises des activités passées et actuelle afin de proposer des améliorations a eu lieu grâce au financement du fond « Partage des savoirs » de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC).
Nos partenaires en Ouganda mènent des activités afin de développer les compétences sociales des jeunes. Améliorer sa confiance en soi, communiquer avec ses amis, sa famille et sa communauté, gérer ses émotions, sont autant d’aspects de la vie qui peuvent être travaillés afin de renforcer sa résilience dans l’adversité. A plusieurs niveaux, nos partenaires s’adressent aussi à différents types de violences qui affectent certains groupes d’enfants et de jeunes vulnérables, qu’elles soient physiques, verbales, émotionnelles ou économiques. Prévention de la discrimination des personnes vivant avec le VIH/sida, lutte contre les violences basées sur le genre, sensibilisation sur la condition de santé mentale des personnes anciennement affiliées à des groupes armés sont autant de problématiques spécifiques qui sont abordées depuis de nombreuses années. Nos partenaires ne sont certes pas tous actifs sur les mêmes groupes de populations. Les mécanismes d’oppression sont néanmoins souvent les mêmes. Il existe un potentiel d’échange de bonne pratique important lorsqu’il s’agit de prévenir et répondre aux violences en tout genre.
"Sous formes de discussions, de jeux et d’exercices, ces sessions interactives ont été construites pour aider les jeunes à questionner leurs relations à eux-mêmes et aux autres afin qu’ils développent leurs propres ressources face à l’adversité et envisagent la différence comme une richesse."
— Adrien Genoud, Directeur d’Omoana
Développer les compétences sociales et prévenir la violence chez les jeunes
Création de sessions interactives pour les jeunes
Entre septembre 2022 et janvier 2023, Omoana et ses partenaires ont travaillé sur des fiches techniques pour mener des séances de groupes auprès des jeunes sur les thématiques suivantes : Conscience de soi- Confiance en soi – Emotions- Gestion du stress- Gestion de la colère – Gestion de conflit– Mécanismes de discrimination- Confiance- Collaboration- Amitié saine et toxique – Réseaux sociaux- Inclusion des personnes vivant avec le VIH/sida- Violences basées sur le genre- Inclusion des personnes vivant avec un handicap- Inclusion des personnes anciennement affiliées à des groupes armés. Les travailleurs sociaux ainsi que d’anciens bénéficiaires aujourd’hui actifs comme mentors auprès d’autres jeunes, ont construit de nouvelles sessions avec le soutien d’Omoana. En février 2023, ils les ont présentées aux autres partenaires lors d’un atelier. Sous formes de discussions, de jeux et d’exercices, ces sessions interactives ont été construites pour aider les jeunes à questionner leurs relations à eux-mêmes et aux autres afin qu’ils développent leurs propres ressources face à l’adversité et envisagent la différence comme une richesse.
Tester des solutions par l’action à travers Théâtre Forum
Lors de ces ateliers, les participant ont aussi reçu une formation introductive au théâtre forum. Le théâtre forum est une technique interactive faisant partie du Théâtre de l’opprimé, développé par Augusto Boal au Brésil. Il permet la création et la présentation de courtes scènes en lien avec des problématiques sociales qui exposent une situation qui doit être changée. Après une première représentation, les spectateurs sont invités à remplacer un acteur sur scène et à essayer de changer la situation, tandis que la représentation est rejouée. D’autres acteurs répondent en adaptant leur personnage, en maintenant ou en ajustant leur pouvoir d’oppression ou d’exploitation par rapport à ce qui a été changé. Le Théâtre Forum offre un moyen de tester des solutions par l’action. Le public fait et évalue tous les choix. Lors de l’atelier, les participants ont particulièrement apprécié cet outil, qu’ils utiliseront en parallèle dans le cadre de leurs activités avec les jeunes pour aborder les thématiques sociales citées ci-dessus.
Ce processus a finalement permis la création du manuel « Youth together » (« Jeunes Ensemble »), qui permettra aux partenaires d’avoir un canevas pour mener au mieux des sessions avec les jeunes. Cela rendra aussi cette nouvelle méthode déployable dans d’autres contextes et projets.
Si vous voulez recevoir le manuel, merci de remplir le formulaire qui se trouve à la fin de la page du projet ICI.
Présentation du projet Omoana House dans Esprit Solidaire
Suite à une visite en Ouganda, Chloé Collier, notre chargée de coordination, a été reçue par le Léman Bleu pour l’enregistrement d’une émission d’Esprit Solidaire, présentant notre projet Omoana House.
Retrouvez l’intégralité de l’émission ici.
L'Ouganda face à la pandémie de Covid-19
Entre avril et juillet dernier, l’Ouganda a connu un taux croissant d’infections à la Covid-19. Cette situation a mis à rude épreuve le système de santé du pays, comme en ont témoigné le nombre de décès et d’hospitalisations liés à la Covid-19. Début juin, un confinement national a été déclaré pour une durée de six semaines. Cette mesure a permis au pays de contrôler le taux d’infection au sein de la population et de dispenser des soins de santé aux personnes les plus gravement malades.
Aujourd’hui, le pays s’ouvre à nouveau. Le taux d’infection a chuté de 21 % à 8 %, le nombre de décès est en baisse et la population respecte davantage les mesures de prévention. La levée du confinement, à la fin du mois de juillet, a permis au secteur des transports et à certains secteurs commerciaux de fonctionner à nouveau. Cependant, d’autres secteurs restent fermés, notamment les établissements d’enseignement, les rassemblements communautaires sociaux et religieux
et le secteur du divertissement et des loisirs.
La vaccination de la population est en cours, avec une priorité donnée aux travailleurs essentiels et aux personnes souffrant de maladies chroniques. L’objectif du gouvernement est de vacciner 50% de la population ougandaise pour permettre au pays de contrôler le taux d’infection. Cependant, à ce jour seulement 1,2 % de la population a été vaccinée. Des fonds d’aide aux victimes de la pandémie ont été versés aux personnes les plus vulnérables. 500 000 d’entre-elles ont ainsi reçu un montant de 100 000 UGX (29 USD) pour un mois. Le gouvernement soutient également la recherche de traitements nationaux contre la Covid-19. Des essais cliniques de traitements à base de plantes ougandaises (COVIDEX et COVICYLE) semblent donner de bons résultats.
Conséquences de la pandémie sur les projets
La fermeture prolongée et répétitive des écoles a exposé les enfants à des problèmes tels que le travail des enfants, le mariage des adolescentes, l’abandon scolaire et la violence, qui semblent affecter davantage les filles.
Dans ce contexte, Omoana a encouragé ses bénéficiaires à s’adapter aux plateformes d’apprentissage virtuel fournies par les écoles ou le gouvernement, tels que les programmes d’études radiophoniques pour les élèves du niveau primaire et les modèles d’apprentissage à distance pour les élèves du secondaire et tertiaire.
Nos partenaires des projets d’éducation, St Moses et Handle Uganda, ont assuré un suivi supplémentaire des étudiants et des tuteurs afin d’éviter les échecs qui pourraient affecter la poursuite scolaire lors de la réouverture des écoles.
Les activités d’Omoana House ont également dû être ajustées. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour restreindre l’accès des personnes extérieures au centre de réhabilitation afin de protéger les enfants qui présentent un risque élevé de vulnérabilité face au virus (en particulier les enfants séropositifs). Un apport nutritionnel supplémentaire a été proposé aux enfants afin de renforcer leur immunité.
Durant cette période la santé des enfants réintégrés dans leurs communautés a été étroitement surveillée et un traitement antirétroviral leur a été distribué à domicile grâce aux Équipes de Santé Villageoises (ESV). Les pairs éducateurs se sont aussi adaptés en approchant les bénéficiaires directement sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), en y menant des campagnes de sensibilisation ciblées et proposant un soutien individuel.
Les opérations du projet de santé mentale ont été principalement affectées par les restrictions sur le nombre de passagers par véhicules et les transports inter-régions. Des activités telles que les sensibilisations dans les communautés ont été interrompues en raison de l’interdiction des rassemblements.
Beaucoup de bénéficiaires sont également confrontés à des problèmes de santé mentale dus à la dépression, au stress et à la stigmatisation des personnes affectées par la Covid-19. Il y a, en effet, beaucoup d’incertitudes sur l’avenir sanitaire mais aussi économique du pays.
Immaculate Achan
Coordinatrice terrain
La jeunesse Ougandaise en quête de nouveaux horizons
Au téléphone, la voix de Michael est calme et déterminée. « On est débordés de travail depuis que le confinement a pris fin. » raconte-t-il depuis Gulu, la ville principale du nord de l’Ouganda.
Michael Ojok, 32 ans, est à la tête d’Hashtag Gulu, une organisation non gouvernementale qui propose des programmes de soutien et de réintégration pour les enfants forcé·e·s à vivre dans la rue et d’y faire les jobs qu’ils·elles peuvent trouver pour réussir à manger chaque jour.
Il décrit que beaucoup de jeunes à Gulu, et dans presque tout l’Ouganda, se sont heurté·e·s aux difficultés d’un marché du travail très fermé et à une économie en pleine évolution frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Faute d’opportunité, beaucoup d’entre eux·elles sont forcé·e·s de faire des choix extrêmes.
Pour Michael, le système éducatif ne prépare pas suffisamment les jeunes Ougandais·es : « Le niveau d’éducation est élevé, mais ce système engendre plus de diplômé·e·s que le marché ne peut en absorber. Un·e jeune qui ne se concentre que sur ses études aura moins de chances de trouver un poste au sortir de l’école. Tu obtiens ton papier mais tu dois trouver des moyens de survivre. On devrait leur faire acquérir des compétences pratiques. Ainsi, les jobs manuels ne seraient pas une solution de dernier recours. Les jeunes doivent être davantage accompagné·e·s. »
Alors beaucoup, pour éviter le pire, tentent de monter leur propre business. Ils·elles déploient une énergie immense et développent des idées inédites. Malheureusement, des prêts quasiment inaccessibles et des compétences qui n’étaient pas au programme scolaire (gestion des clients, réseautage, etc.) ont vite raison de leurs ambitions. La route est cahoteuse.
Elle l’est d’autant plus lorsque, dans l’entourage de ces jeunes, une guerre civile de près de 20 ans a laissé derrière elle de profondes cicatrices psychologiques : agressivité dans les relations de tous les jours, cauchemars fréquents, crises de tremblement… et stigmatisation de ceux·celles qui, au sein d’une communauté, parmi les membres d’une famille, souffrent de ces symptômes. « C’est un sujet que personne n’aborde ouvertement. Il n’y a pas de travail de mémoire », déplore Anett Pfeiffer Tumusiime, directrice de l’ONG Vivo Ouganda soutenue par Omoana.
« Même au sein d’un couple, la tendance est de cacher les horreurs qui ont bien pu se passer durant cette période. Or, tout le monde a été affecté. En termes de santé mentale, ce qui s’est passé il y a 20 ans est aussi vif que si ça s’était passé hier.»
— Anett Pfeiffer Tumusiime, directrice de l’ONG Vivo Ouganda soutenue par Omoana
Vivo Ouganda contribue aux efforts de Hashtag Gulu via des sessions de thérapie narrative proposée aux bénéficiaires de l’ONG de Michael Ojok. Ce partenariat a également permis à certains membres de l’équipe de Hashtag Gulu de recevoir des formations spécifiquement axées sur le traitement de traumatismes. Ainsi, ces deux organisations peuvent fournir une aide psychologique aux personnes les plus traumatisées. Dans certains endroits, des groupes de soutien se sont spontanément mis en place pour assister financièrement d’anciens enfants-soldats. Des programmes radio participent aussi à briser le silence et réduire la stigmatisation. « Le changement se fait progressivement mais c’est un processus long et complexe », explique Immaculate Achan, chargée de programme pour Omoana.
« Ce processus est essentiel, rappelle Anett, puisque les parents d’aujourd’hui étaient enfants durant la guerre civile. Ce sont ceux·celles qui ont le plus souffert des actes commis durant ce conflit qui élèvent désormais la génération suivante ».
A l’autre bout du fil, Michael, père d’une petite fille, aimerait voir plus loin. Il reconnaît l’importance d’une telle conversation « pour être sûr qu’une telle violence ne se reproduise plus » mais plaide pour la recherche d’un équilibre subtil : « Comment peut-on reconnaître les atrocités commises tout en ne se focalisant pas dessus ? Je crois qu’il est temps qu’on passe du rôle de victimes à celui de survivants. On doit se demander : comment puis-je faire des projets et réussir ce que j’entreprends sans revenir sans cesse à ce conflit ? La difficulté est là : s’éloigner du récit de cette guerre et se concentrer sur les défis qui nous attendent. On ne peut pas continuer à mettre la situation actuelle sur le dos de la guerre civile, quelque chose doit changer. Quelles sont les opportunités qui existent ? et comment la jeune génération peut-elle y accéder ? »