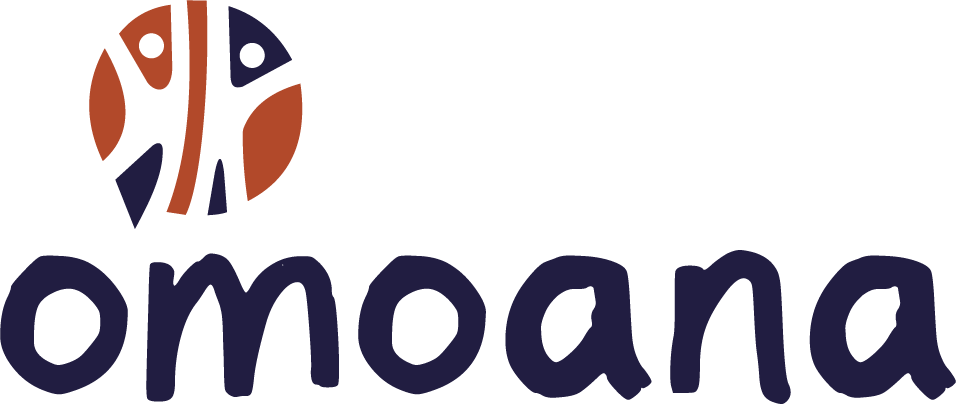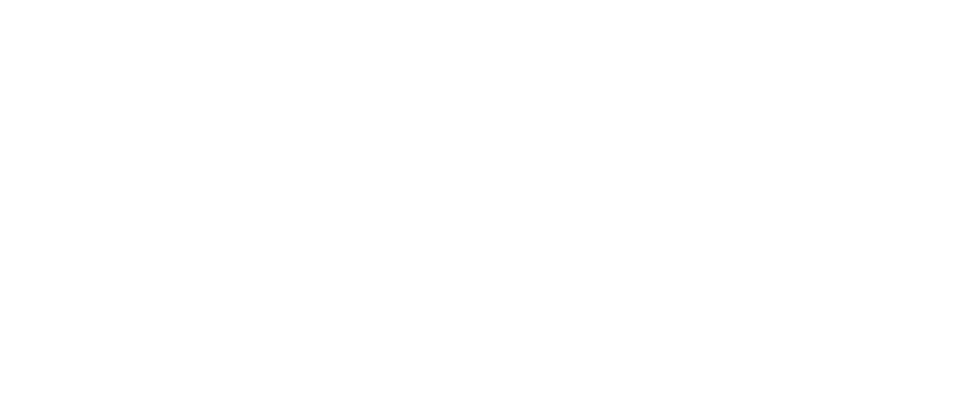Un réseau de promoteurs de la paix en Afrique des Grands Lacs
Avec le soutien de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC), Omoana et Eirene Suisse ont mis en place un atelier d’échange sur les différentes pratiques auprès de populations traumatisées par la guerre en République Démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et en Ouganda. Récit.
C’est dans la ville de Huye, située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale rwandaise de Kigali que se sont réunis les partenaires régionaux d’Eirene Suisse et Omoana durant 6 jours. Les 25 participants sont pour certains venus d’Ouganda (Handle, ACOT et Vivo, Omoana), d’autres étaient presque à domicile (les associations rwandaises Réseau des femmes, Umuseke et l’Association Modeste et Innocent), tandis que les représentants de Pole Insitute sont venus depuis la République Démocratique du Congo. Magali Perrin, coordinatrice d’Omoana et Sophie Grangier, membre du comité étaient également présentes.
Taï Chi et méditation
L’ambition de cet atelier était grande: amener des organisations de différents pays à échanger sur leurs méthodes de travail alors que les participants ne parlent pas la même langue. Néanmoins ces organisations partagent un objectif commun, chacune dans leur région et à leur façon, œuvrent à accompagner les personnes traumatisées. Les ONG ougandaises utilisent la psychologie pour permettre aux personnes touchées par les conflits qui agitent le pays de se reconstruire. Pour les ONG rwandaises, c’est en faisant notamment recours à la thérapie sociale qu’elles œuvrent à la réconciliation des communautés qui ont implosées lors du génocide.
Malgré les barrières linguistiques, les participants ont habilement été poussés à se mélanger. Les échanges entre anglophones et francophones se sont multipliés malgré un commencement timide durant lequel les participants s’étaient scindés en deux, avec d’un côté les «pro-Molière» et de l’autre les «pro-Shakespeare». Après quelque temps, c’est spontanément que certains se sont rassemblés à l’aube pour organiser des séances de Taï Chï et de méditation. Les participants ont découvert les groupes de parole dans lesquels des survivants du génocide et des anciens génocidaires se retrouvent pour discuter et s’entraider. Une situation relativement fréquente notamment dans le cadre de compensations que doivent verser des anciens prisonniers à leurs victimes, un des pans du processus de réconciliation nationale.
Des coopérations à venir
Le dernier jour de ce rassemblement a été consacré à la visite du projet de thérapie sociale mis en place par l’Association Modeste et Innocent depuis 2013 avec le concours d’Eirene. Les participants et les bénéficiaires de la thérapie sociale se sont divisés en petits groupes afin de partager leur parcours de vie. Durant ces échanges, les participants ont constaté l’ampleur du travail accompli par Noëlla, Médiatrice et Gilbert, les animateurs de l’AMI. Dans l’un des groupes, deux voisins expliquaient leur expérience différente durant le génocide. Le premier a perdu une partie de sa famille sous les coups du second. Cependant, grâce au dialogue et l’échange, ils se retrouvent maintenant régulièrement dans le cadre des groupes de paroles, leur permettant de dépasser l’indicible.
Les participants ont été impressionnés par le travail effectué et désireux de pouvoir l’appliquer chez eux. Cela a eu une résonnance particulière pour un participant de RDC qui déplore le manque d’effort dans son pays pour travailler à un processus de réconciliation. Comme souvent au Rwanda, cette visite s’est terminée par une fête improvisée durant laquelle les participants ont pu danser sur les rythmes rwandais et découvrir les spécialités culinaires de la région.
Le jour du départ, les participants ont spontanément échangé leurs coordonnées. Suite à un dernier exercice de «Marché» d’échanges, les participants ont partagé les méthodes qui les intéressaient chez l’autre. Quelques mois après la fin de cet atelier, il existe déjà des collaborations entre des organisations qui désirent envoyer l’un de leurs animateurs en immersion dans l’autre structure, mais également des mises en commun de forces afin de construire des projets plus ambitieux. En rapprochant nos partenaires dans la région des grands lacs, avec le support financier de la Fédération Genevoise de Coopération, nous renforçons le travail effectué par ces structures et nous facilitons la diffusion de pratiques locales efficaces.
Bastien Morard
Chargé de Programme Grands Lacs
Eirene Suisse
Lutter contre les violences basées sur le genre: impliquons les hommes
Depuis janvier 2018, avec le soutien d’Omoana, Handle Uganda met en place un projet de prévention des violences basées sur le genre. Cela contribue à favoriser une dynamique familiale favorable au bien-être des enfants. En voici une description...

HANDLE Uganda est une petite ONG locale basée à Gulu, au nord de l’Ouganda, une région qui fait encore face aux conséquences dévastatrices d’une guerre civile longue de vingt ans. L’organisation a débuté un projet de trois ans dans le district de Nwoya afin de lutter contre la violence basée sur le genre (VBG), fortement répandue au nord de l’Ouganda pendant et après le conflit. Ce projet ambitieux développe une approche pluridimensionnelle et holistique afin de répondre au problème de VBG aux niveaux individuel, familial, communautaire ainsi qu’auprès du gouvernement local.
Outre divers types de violences physiques, la VBG prend aussi la forme d’un accès inégal à la propriété foncière et aux différents moyens de production et sources de revenus. Afin d’y remédier, HANDLE promeut les droits des femmes et l’égalité avec les hommes en offrant à 300 femmes en situation de pauvreté un support dans la création d’assemblées villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) afin de renforcer leur alphabétisation financière. De surcroît, l’organisation fournit des formations et un accompagnement dans la création et la gestion de micro-entreprises. L’objectif est de renforcer l’indépendance financière des femmes par rapport aux hommes afin de gagner en autonomie et tendre vers une position paritaire.
Ces femmes sont aussi informées sur leurs droits et ce qui définit les VBG, de telle manière qu’elles puissent reconnaitre les diverses formes de discriminations et de violations à leur encontre. Elles reçoivent des informations sur ce qu’elles peuvent faire si elles-mêmes ou des femmes de leur entourage sont victimes de VBG. Les ressources nécessaires pour accéder aux services légaux et médicaux sont aussi mises à leur disposition. HANDLE a dans ce but une représentante légale qui apporte son soutien aux victimes en les dirigeant vers les services adéquats pour les cas les plus graves, et en assurant un service de médiation auprès des familles pour les cas de disputes conjugales.
HANDLE apporte également son soutien en cas de conflit foncier afin de limiter la tournure dramatique que ceux-ci prennent souvent. Un service de médiation est à disposition des familles et communautés concernées par de tels problèmes, ainsi qu’un support légal si besoin est. Si la privation d’accès à la propriété est en soi déjà une atteinte aux droits des femmes, elle dégénère souvent en violence physique, de manière particulièrement marquée au sein d’une population encore traumatisée par la guerre civile. Il est dès lors important de ne pas négliger cette problématique.
Avec les hommes aussi…
Le projet ne se limite néanmoins pas aux femmes. En effet, HANDLE forme aussi des groupes d’hommes-modèles constitués d’hommes de divers niveaux d’influence et origines sociales, allant des paysans aux Rwotkweris (chefs de clan). Trois groupes de trente hommes chacun reçoivent une formation intensive afin de jouer le rôle de vecteur de changement au sein de leur village et de leur communauté. Ils acquièrent des connaissances sur la VBG, les droits des femmes et sur ce qu’ils peuvent faire pour influencer et éduquer les membres de leur communauté.
Chaque homme ainsi formé représente un modèle pour sa famille et ses voisins et œuvre de manière intensive auprès de dix familles en situation de conflit, plus particulièrement de VBG. Les hommes-modèles bénéficient en outre de formations de base en service de consultation et de gestion de conflit pour les cas de VBG. Des vélos sont aussi mis à leur disposition pour mener à bien leur travail de mobilisation communautaire et leurs devoirs de médiateurs.
HANDLE travaille aussi de manière étroite avec le gouvernement local, la police et les autres parties prenantes afin de renforcer ses initiatives. Conjointement avec les autorités concernées, l’organisation réalise un important travail de sensibilisation auprès des communautés au travers d’événements culturels. A ces occasions, les différents leaders s’expriment contre la VBG et informent leur communauté de ses conséquences néfastes. Les forces de police sont quant à elles formées sur la façon de reconnaître les cas de VBG et signaler les crimes commis, ainsi que sur l’importance de signaler les cas le plus rapidement possible et préserver les preuves, spécialement dans les cas de violence sexuelle.
HANDLE se réjouit de travailler avec différents partenaires et bénéficiaires pour améliorer la qualité de vie des femmes, des hommes et des enfants au sein de leur communauté et participer à la réduction de la VBG dans la région.
Emma McGeachy
Le droit à l’éducation : une réalité ?
Certains enfants, issus de familles particulièrement démunies, ne pourraient poursuivre leur scolarité sans une aide extérieure. Leur famille ne parvenant pas à assumer les frais d’éducation, ils seraient contraints, par manque de ressources, d’arrêter l’école en cours de chemin et, comme tant d’autres, de se contenter d’une vie d’expédients, au jour le jour. Mais attention, les projets de parrainage scolaire sont là pour soutenir et accompagner des familles dans le besoin, et non pas se substituer à elles.
Omoana travaille en partenariat avec 2 associations distinctes qui mettent en œuvre les projets de parrainage scolaire. Le premier partenariat a commencé en 2003, au sud du pays, avec St Moses CCC (St Moses Children’s Care Center and Community Development), fondée en 1973 en tant que centre pour les enfants abandonnés, indigents et déplacés. Il sponsorise actuellement un total de 163 enfants, dont 66 à travers Omoana. Le centre héberge, si nécessaire, une partie des enfants. Lesactivités consistent à offrir aux élèves des services de conseil, d’orientation et de soutien psychologique, ainsi qu’un suivi médical. Un accent est mis sur le développement de leurs aptitudes sociales et une éducation chrétienne pour l’ensemble des enfants, qu’ils soient résidents ou non. Et pour finir, l’association assure le paiement des écolages et le suivi des élèves. Le développement communautaire et durable des familles est promu au travers de formations, desuivis et de soutien par le biais d’un projet de microfinance.
Un deuxième projet de parrainage fut mis en place au nord, dans la région post-conflit de Gulu, en 2009. Il est actuellement géré par HANDLE Uganda (Hope Alert Network for Development and Local Empowerment), une ONG fondée en 2009 dans le but de combler les lacunes dans les prestations de services aux communautés en cours de réhabilitation et de reconstruction. Le projet accompagne 29 élèves évoluant dans différents niveaux d’éducation, du primaire jusqu’à l’université, en passant par les écoles professionnelles. Les activités sont sensiblement similaires à celles de St Moses, exception faite du centre pour résidents. Les membres de l’équipe sont basés en ville de Gulu et se déplacent pour le suivi des élèves. Ils effectuent des visites auprès des familles afin de discuter des enjeux quotidiens, et comprendre le contexte de vie des pupilles. Ils se rendent également auprès des centres d’enseignement pour payer les écolages et faire le point avec les enseignants.
Les enjeux sont nombreux, particulièrement l’abandon et l’échec scolaires. Certains parents ne jouent pas leur rôle dans l’équation, pour des raisons financières ou démissionnaires. De ce fait, la limite entre l’implication des équipes de projets et le rôle des familles est difficile à définir. Les familles ont à charge une partie des frais scolaires, mais peut-on ignorer un enfant qui ne peut étudier par manque de matériel scolaire de base ? Dans le même temps, les attentes, justifiées ou non, sont parfois très élevées, et certains parents se reposent complètement sur les associations pour gérer les difficultés.
Les équipes de projet doivent créer un climat de confiance favorisant le dialogue avec les pupilles et leur famille; entendre les difficultés de chacun et trouver des solutions au cas par cas : qui doit changer pour une école professionnelle pour cause de difficultés scolaires, qui doit quitter le programme suite à des abus de confiance, qui doit entrer en pensionnat pour échapper à la surcharge de travaux domestiques empêchant l’étude ou avoir accès à une école de meilleure qualité,… ?
Il faut savoir qu’en Ouganda, les enfants ont très tôt beaucoup de responsabilités, les filles en particulier. Ils sont en charge des travaux domestiques – chercher de l’eau au puits, la cuisine, le ménage – et dans le même temps s’occupent des enfants plus jeunes ou de parents malades. Ces obligations ne vont pas diminuer parce qu’ils doivent étudier. Et puis il y a les filles mères sans mari et sans ressources, l’entrée dans l’adolescence, des distances parfois énormes pour atteindre son école, pour ne citer que quelques problématiques parmi tant d’autres.
Pour couronner le tout, la qualité du système scolaire public en Ouganda est un vrai problème, en particulier dans les régions reculées, et les coûts de scolarité ne cessent d’augmenter suite à l’inflation et la participation limitée du gouvernement dans son développement.
Mon intention n’est pas de vous peindre un tableau bien sombre de la situation, mais bien plus de mettre en évidence l’infinité de particularités auxquelles le personnel engagé dans ce travail doit faire face.
En conclusion, en raison du nombre croissant d’enfants dans le besoin, les moyens mis en œuvre pour aider ces familles ne suffisent pas. En permettant à un enfant de suivre une scolarité normale et d’y poursuivre des études secondaires, vous lui offrez la chance de se construire un véritable avenir et de participer, demain, au développement de son pays. Et il vous enremercie très sincèrement.
Magali Perrin
Coordinatrice
Visite de professionnels de l’humanitaire
Omoana House, bien plus qu’un projet
En avril 2016, des professionnels de l’humanitaire engagés dans un certificat en méthodologie de projet avec le Centre d’étude et de recherche en action humanitaire (CERAH) ont visité Omoana House. Ils étaient réunis durant 10 jours en Ouganda pour la partie « résidentielle » de la formation (une formation à distance qui dure 7 mois et comprend également des sessions à distance et 4 mois de coaching). Un cas pratique a été organisé avec Omoana House dans le cadre duquel les étudiants ont échangé avec les adolescents séropositifs afin de connaître leurs défis quotidiens et comment Omoana House y répond. Au-delà des aspects techniques, le groupe a été marqué par le courage de ces jeunes, et par la relation humaine avec le staff. De leur côté, les adolescents ont apprécié ce moment d’échange, ce qui a mis en exergue la nécessité de les inclure de manière plus systématique dans la planification du projet. Dr. Edith Favoreu, formatrice et directrice adjointe du CERAH nous donne ses impressions.
Omoana… plus qu’un nom, c’est une poésie. Un chemin vers une bulle de bonheur qui éclabousse d’énergie positive tout autant les enfants que chaque visiteur. Alors que les premiers y trouvent un refuge bienveillant et plein d’amour, une antre d’une chaleur humaine sans pareil, les seconds y puisent une force de vie qui les marque à jamais.
Omoana… plus qu’un projet, c’est un concept novateur, où l’être est replacé dans sa dimension centrale, première, primordiale, où chacune de ses composantes est reconnue comme une source intarissable de transformation intérieure. Le visiteur ne peut s’y méprendre, Omoana est unique et sa force est incommensurable.
Omoana … plus qu’un soutien, c’est une véritable inspiration. Enfants, jeunes adultes, accompagnateurs sont des modèles, donnant tout son sens au concept de résilience. Ne niant jamais les complexités intrinsèques à la situation sociale, sanitaire, politique et économique du pays, chacun les appréhende pourtant, véritable leçon de vie pour chaque visiteur.
Nous avons été ces témoins émus de tant de grandeur. Chanceux de pouvoir passer une journée à Omoana House, fortunés de partager un peu du quotidien de cette maison unique. Nous, professionnels de l’Humanitaire et du développement. Nous, habitués des contextes difficiles dans lesquels la souffrance a tant de visage. Nous, qui croyons que notre travail peut contribuer à limiter cette souffrance, redonner l’espoir. Nous, nous avons tous été bouleversés et enthousiasmés par ces moments précieux avec les enfants, les adolescents et toute l’équipe tant investie. Nous, nous sommes repartis de Jinja différents, meilleurs, plus fort, plus grands, et si admiratifs.
Nous, venant de partout (Brésil, Sénégal, Suisse, France, Soudan, Ethiopie, Cameroun…), travaillant pour l’Université de Genève, le comité International de la Croix-Rouge, l’organisation mondiale pour la nourriture et l’agriculture, NRC, etc., tous investis dans un programme de formation universitaire de haut niveau, nous vous remercions. Nous avions pensé apporter notre support à Omoana House, investigués avec les jeunes sur la perception qu’ils ont du centre, leurs perspectives. Nous avions cru à un exercice d’analyse des besoins dans lequel on applique des techniques, des outils, le tout colorés de savoir-être. Nous, nous avons l’impression que nous avons beaucoup plus appris qu’apporté, beaucoup plus reçu que donné, beaucoup plus grandi que contribué.
Omoana House, votre travail est malheureusement indispensable. La façon dont vous le développez est admirable. Merci de donner corps au mot solidarité, compassion et amour. Merci de nous avoir accueilli pour cette journée d’étude transformée en leçon de vie.
Dr. Edith Favoreu
Directrice adjointe
CERAH
Université de Genève/Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement
Editorial du président, janvier 2017
Plus de réfugiés ont fui vers l’Ouganda que vers l’Europe en 2016. Selon Norwegian Refugee Council, 489,000 Soudanais du Sud se sont réfugiés en Ouganda, alors que 362’000 personnes traversaient la méditerranée. Cela rappelle une chose. Lors des crises humanitaires qui secouent la planète, les premiers à venir en aide aux personnes touchées sont les proches. Lors de guerres ou d’épidémies, ce sont les voisins et les familles qui porteront secours à des personnes parfois agonisantes.
Que cela veut-il dire ? Que le gros du travail est mis en œuvre par les personnes sur place, et non par des Européens dévoués, qui, en plus de nombreux réfugiés accueillis dans leur pays financent les organisations humanitaires. Non, en Ouganda comme au Moyen-Orient, les populations ne sont pas que victimes ou bourreaux. Elles abritent également les principaux héros qui, empathiques et courageux, viennent en aide à ceux qui en ont besoin.
Dans leur travail, Omoana et ses partenaires ont pu constater le rôle clé des communautés pour faire face aux crises. Ce sont souvent les grand-mères qui s’occupent d’enfants orphelins et séropositifs. Ce sont les communautés qui ont soutenu les enfants soldats traumatisés, de retour au village, et ce sont les Ougandais les principaux acteurs dans l’accueil des Soudanais du Sud. En effet, le seul camp de Bidibidi reçoit plus de 270’000 réfugiés, soit l’équivalent de deux fois la population de la ville de Lausanne.
Les bénéficiaires doivent être consultés, car ce sont les plus à même de répondre aux principales problématiques, exprimer les besoins, mais surtout suggérer les activités pour y faire face. C’est ainsi que l’association doit mettre en œuvre une approche participative pour chaque projet. Nous vous remercions, chers donateurs, d’y croire et vous souhaitons le meilleur pour l’année 2017.
Adrien Genoud
Président
La paix se construit ensemble
« On nous a dit qu’il fallait aimer son prochain, on ne nous a pas dit comment. » Cette réflexion d’un citoyen congolais que j’ai rencontré lors d’une visite en Afrique des Grands Lacs pour l’ONG Eirene Suisse en dit long et reflète certainement un état de fait dans chaque pays du monde. Le vivre ensemble : un défi tant local que global. L’humanité souffre-t-elle d’une carence d’empathie ?
En Afrique des Grands Lacs, tout comme en Europe, le mépris de celui qu’on ne connaît pas, ou que l’on ne veut connaître prend encore une place trop grande. En découlent notamment toutes sortes de discriminations, ainsi que le manque de considération de l’autre. Partout le même mécanisme: Des clichés simplificateurs permettent de catégoriser en groupe et de généraliser le jugement à l’ensemble du groupe, menant à l’exclusion. A cela s’ajoute ce qu’on ne veut simplement pas voir. Ignorer les sentiments de l’autre peut s’avérer tout simplement plus confortable. Ainsi on se regarde en chien de faïence. Le racisme, en Europe comme ailleurs, semble un fléau indomptable. Face au terrorisme, on parle plus facilement de guerre que de paix. Et pourtant… Comment construire la paix ? Dans les médias, on entend peu ceux qui, à l’image d’un Mandela ou d’un Gandhi, ont poussé des peuples entiers à la réflexion, à une intelligence collective au service du vivre ensemble. Au Nord de l’Ouganda, Omoana compte sur un réseau de leaders de la paix qui tentent d’avancer malgré des blessures d’une ampleur inimaginable : renforcement économique (si possible pour tous), gestion des traumatismes, programmes d’éducation afin de donner des perspectives à la jeunesse… La gravité de la situation nécessite une mise en commun des ressources et des savoirs. Face à la complexité de la bêtise humaine, le partage d’expériences et l’apprentissage commun prennent tout leur sens. Qu’on le veuille ou non, la promotion de la paix nous concerne tous, car personne n’est à l’abri de la violence. Savoir communiquer, surpasser les clivages et prendre en considération les perspectives de l’autre ne sont pas innés. Ainsi, nous nous devons de favoriser les échanges pour laisser la place à la réflexion et l’innovation. Cela concerne les acteurs de la société civile ougandaise, mais pas seulement. L’Europe pourrait en effet également apprendre de ceux qui, à l’image des peuples d’Afrique des Grands Lacs ont été confrontés aux plus grands traumatismes. Prenons donc la mesure des défis qui s’annoncent à nous pour mieux les affronter. Cela ne pourra se faire qu’ensemble. Saisissons cette opportunité!
Adrien Genoud
Président
Plus de téléphones portables que d’ampoules électriques
Nous connaissons tous ces statistiques insolites et autres classements internationaux qui prêtent souvent à sourire : les Suisses sont les champions de la consommation de chocolat, les Tchèques se distinguent par leur consommation de bière, il y aurait en Finlande plus de saunas en fonction que de voitures en circulation, la France peut se targuer d’être le pays des plus de 300 fromages, etc. Dans ces olympiades des particularités nationales, l’Ouganda n’est pas en reste. En effet, on dénombrerait dans ce pays d’Afrique plus de téléphones portables que d’ampoules électriques !
Tirée d’un article de la journaliste Dara Kerr paru en 2009 (For Uganda’s poor, a cellular connexion, CNet) cette comparaison entre téléphones portables et ampoules, a priori anecdotique, n’est en réalité pas dénuée de tout intérêt. Cette statistique peut même s’avérer riche d’enseignements quant à l’état de développement économique du pays et à ses opportunités futures. Par ailleurs, elle montre que les étapes menant à la diminution de la pauvreté peuvent être innovantes et multiples.
Sous nos latitudes, l’accès à l’électricité n’est pas considéré comme un luxe réservé à quelques privilégiés mais bien comme un service de base, au même titre que l’accès à l’eau courante et potable, à des soins médicaux et à une éducation de qualité. Dès lors, vu d’un pays riche, c’est certainement la faible utilisation d’ampoules qui tend à surprendre en premier lieu ; celle-ci traduisant le manque d’accès à l’énergie électrique. Selon les chiffres de la Banque Mondiale, moins de 20% de la population ougandaise est connectée au réseau électrique. Ainsi, la très grande majorité des ménages cuisine au feu de bois et leurs enfants font leurs devoirs à la lumière de la lampe à huile, autant polluants que nocifs pour la santé. Certainement plus parlant que la simple comparaison des PIB nationaux, cet aspect du développement économique permet de mesurer concrètement l’écart qui sépare notre niveau de vie de celui d’une famille ougandaise moyenne. Outre ce terrible constat, peut-on voir dans notre comparaison initiale entre téléphones portables et ampoules quelques perspectives réjouissantes ? Fort heureusement, la réponse est oui !
Alors que la diffusion de l’énergie électrique tarde, celle de la téléphonie mobile est fulgurante et laisse entrevoir des opportunités, non seulement en Ouganda, mais aussi dans de nombreux pays en voie développement. Rechargés à l’énergie solaire ou à l’aide de batteries de voiture, les téléphones portables offrent pléthore de services par SMS. Dans un contexte où l’accès à l’information est limité, le téléphone fait tout d’abord figure de vecteur idéal de diffusion. Des informations relatives aux prévisions météorologiques, à la propagation des épidémies, à la localisation des centres de soins les plus proches, ou encore aux méthodes agricoles recommandées, deviennent ainsi accessibles aux habitants des régions les plus reculées. En plus d’informer, le téléphone se révèle aussi être une voie d’accès aux services financiers qui font tant défaut dans ces pays. Grâce à des systèmes tels que M-Pesa – littéralement « mobile money » – le téléphone portable devient un compte en banque permettant de payer, d’épargner, ou d’emprunter, le tout à des coûts de transaction réduits. Les téléphones devenant smart et offrant l’accès à internet et à toutes sortes d’applications, il ne fait aucun doute que leur potentiel est encore immense et laisse augurer d’importantes avancées autant pour l’économie, que pour la santé ou l’éducation.
Notons finalement que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que la téléphonie mobile soit en mesure de contribuer à amener la lumière et l’électricité dans les foyers africains. En effet, un récent article paru dans le Guardian (The Africans buying sunshine with their phones, 2016) rapportait le succès commercial d’un kit d’énergie solaire, comprenant un panneau solaire, une batterie rechargeable, deux ampoules et une lampe de poche LED, ainsi que d’un adaptateur servant à recharger les téléphones. De prime abord inabordable pour de nombreuses familles, ce kit a la particularité d’être vendu à crédit, moyennant des remboursements réguliers (50 centimes par jour)…directement prélevés sur le téléphone portable des acheteurs ! Il se pourrait donc que la vaste utilisation des téléphones portables, couplée à des solutions innovantes, puisse faciliter l’accès à des biens et services de base, tel que l’électricité.
Simon Berset
Trésorier
Soyons du bon côté de l’histoire le 28 février 2016
Contrairement à « mourir de rire » ou « mourir de peur », simples figures de style, « mourir de faim » n’est pas une expression mais une réalité. Dans le monde, un enfant meurt toutes les 5 secondes des suites de la malnutrition et de la faim. Ceux qui en survivent le font au prix de douleurs et de séquelles à long terme.
Outre les nombreuses infections favorisées par un système immunitaire affaibli, la malnutrition a des conséquences à vie sur leurs capacités mentales, cognitives et donc sur leurs perspectives de revenus futurs. Une grande partie des enfants malnutris accueillis à Omoana House ont ainsi été élevés par des personnes qui l’ont eux-mêmes été durant les premières années de leur vie, affectant ainsi leurs capacités mentales, donc leur situation économique et leur sécurité alimentaire, engendrant ainsi un cercle vicieux.
Il serait faux de penser que la faim dans le monde est uniquement un phénomène lointain dû à un manque de ressources des pays du Sud. Cette planète a assez de nourriture pour 10 milliards d’habitants. Comment se fait-il que tant d’enfants agonisent encore de la faim ? Les causes sont multiples. Les plus connues sont la mauvaise gouvernance de certains Etats en proie à la dictature ou victimes de la corruption à large échelle, ainsi que les changements climatiques. Des pratiques axées vers le profit ont également une influence sur la sécurité alimentaire dans le monde. Une partie de la nourriture produite est utilisée pour les agro carburants ou pour nourrir le bétail. L’eau potable, élément indispensable à une nutrition de qualité, n’est pas toujours disponible et parfois privatisée par des géants de l’agroalimentaire. De nombreuses terres des paysans du Sud sont expropriées par des compagnies occidentales, chinoises ou indiennes, pour y implanter des monocultures désastreuses pour l’environnement, au détriment de l’agriculture familiale si nécessaire à une sécurité alimentaire durable. Une pratique ayant ses assises en Suisse joue également un rôle important dans ce désastre. Il s’agit de la spéculation sur les matières premières alimentaires. Des traders basés en Occident achètent des quantités gigantesques de céréales et les revendent à un moment profitable. Ils favorisent la rareté pour que les prix atteignent des montants invraisemblables. Quelle est la conséquence de cette pratique ? Une fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, ce qui a des effets désastreux sur la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres. Quelle en est l’utilité? Enrichir des traders à Genève et Zurich, et remplir les caisses des communes, cantons et pays qui accueillent de telles compagnies. Une autre utilité ? Simplement une manière de maintenir un système financier commettant l’un des crimes contre l’humanité le plus crasse pour l’enrichissement de certains. Il est à se demander quand le monde se réveillera. Quand considèrera-t-il la faim dans le monde à sa juste valeur, c’est-à-dire un mal à combattre avec la même vigueur que l’esclavage, la Shoah ou l’apartheid? Cela impliquerait de lutter contre chaque cause de ce phénomène.
En février, le peuple votera sur une initiative visant à interdire la spéculation sur les matières premières alimentaires en Suisse. Elle supprimerait uniquement la spéculation financière motivée par les gains à court terme. En revanche, elle ne toucherait pas au commerce direct et aux transactions sur le marché réel, ni aux couvertures de prix, qui eux permettent la stabilisation du système. Certains craignent qu’elle nuise à l’économie suisse. Quoi qu’il en soit, il serait temps de savoir jusqu’où nous sommes prêts à aller pour notre prospérité. Rappelons que, malgré ce que l’on peut dire, la Suisse n’a pas toujours été du bon côté de l’histoire. Il s’agit aujourd’hui de savoir si elle est prête à défendre des valeurs et avoir une vision à long terme. De plus, certaines entreprises ont déjà compris l’impact funeste de la spéculation financière sur les prix des denrées alimentaires et ont pris leurs responsabilités. Ainsi, le fond de l’AVS ou Raiffeisen se sont retirés de ce marché. Cela contredit donc les dire d’Economie Suisse qui prétend que combattre cette spéculation n’aurait aucun effet positif. Le but d’Omoana est de défendre les droits des enfants d’Ouganda, et c’est dans cette optique que nous vous encourageons à vous renseigner sur l’initiative « Pas de spéculation sur les denrées alimentaires » qui sera soumise au vote le 28 février sur : http://stopspeculation.ch .